|
Texaco / Patrick Chamoiseau. -
Paris : Gallimard, 1992. - 432 p. ;
21 cm.
ISBN 2-07-072750-5
|
|
NOTE
DE L'ÉDITEUR :
« Une vieille femme câpresse,
très grande, très maigre avec un visage grave,
solennel, et des yeux immobiles. Je n'avais jamais perçu
autant d'autorité profonde irradier de
quelqu'un … Elle mélangeait le
créole et le français, le mot vulgaire, le mot
précieux, le mot oublié, le mot
nouveau … » Et c'est ainsi que
Marie-Sophie Laborieux raconte à l'auteur plus de cent
cinquante ans d'histoire, d'épopée de la
Martinique, depuis les sombres plantations esclavagistes jusqu'au drame
contemporain de la conquête des villes.
D'abord, les amours
d'Esternome, « le
nègre-chien » affranchi, avec la volage
Ninon qui périt grillée dans l'explosion de la
Montagne Pelée, puis avec Idoménée
l'aveugle aux larmes de lumière, qui sera la mère
de Marie-Sophie. Dans les temps modernes, Marie-Sophie erre d'un
maître à l'autre au gré de mille et un
« djobs » qui l'initient
à l'implacable univers urbain. Ses amours sont sans
lendemain. Devenue l'âme du quartier Texaco, elle
mène la révolte contre les mulâtres de
la ville, contre les békès qui veulent
s'approprier les terres, contre les programmes de
développement qui font le temps-béton.
C'est cette femme de combat
que le Christ (un urbaniste chargé de raser le quartier
Texaco) affrontera lors d'une ultime bataille où les forces
de la Parole resteront la seule arme.
Patrick Chamoiseau a sans
doute écrit, avec Texaco, le grand livre
de l'espérance et de l'amertume du peuple antillais, depuis
l'horreur des chaînes jusqu'au mensonge de la politique de
développement moderne. Il brosse les scènes de la
vie quotidienne, les moments historiques, les fables
créoles, les poèmes incantatoires, les
rêves, les récits satiriques. Monde en
ébullition où la souffrance et la joie semblent
naître au même instant.
|
|
JACQUES
COURSIL : […]
Sous les formes qui lui sont
propres, le roman Texaco est l'histoire de la
muette qui parle. Dans ce roman qui raconte le
« squat », par des occupants
opiniâtres, d'un dépôt de carburant
situé à la périphérie
urbaine, le créole, langue sans lecteurs (mais non sans
auteurs), fait son éloge dans l'autre langue. Dans la guerre
et le siège de ce lieu nommé par
métonymie « Texaco »,
lieu qui deviendra un quartier de la ville de Fort-de-France, le
lecteur de Chamoiseau découvre une guerre et un
siège des langues.
Sous la langue
française qui décrit chaque personnage, il y en a
une autre qui crie.
[…]
☐ « L'éloge
de la muette », Espaces Créoles, 9/1999,
p. 32
|
| EXTRAIT |
Idoménée lui dit
Fort-de-France comme elle n'eut jamais le temps de me le dire. Mon
Esternome, malgré la ruine de sa mémoire, put
quand même me suggérer ses mots car la
présence d'Idoménée
l'imprégna très profond. Elle fut la
mémoire de son âge sans mémoire. Ce
qu'il savait de Saint-Pierre complétait ce qu'elle disait de
Fort-de-France. Ce qu'elle en savait provenait des paroles entendues
par hasard tout au long de sa vie, paroles nées des salons,
échappées des promenades sur l'Allée
des Soupirs, paroles perçues lors des attentes aux quais,
paroles tombées des soldats-sentinelles qui faisaient les
cent pas sous les murailles du Fort. Dans la chaleur qui les figeait,
l'Idoménée songeuse allongée dans ses
bras, ils s'échangeaient ces morceaux de paroles,
à mi-voix-à-mi-mots afin de ne pas transpirer.
Mots déjà rabâchés mais qui
de mois en mois, s'enrichissaient d'une nuance. Mots qui les lovaient
en plein cœur de l'En-ville et les liaient comme une corde.
☐
p. 193
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Texaco »,
Paris : Gallimard (Folio, 2634), 1994
- «
Texaco » traduzione di Sergio Atzeni,
Torino : Einaudi, 1994 ; Nuoro : Il
Maestrale, 2004
- « Texaco »
traducción de Emma Calatayud, Barcelona : Anagrama,
1994
- « Texaco »
translated by Rose-Myriam Réjouis and Val Vinokurov, New
York : Pantheon books, 1997
|
|
|
- « Manman
Dlo contre la fée Carabosse »,
Paris : Ed. Caribéennes, 1982
- « Chronique
des sept misères », Paris :
Gallimard, 1986 ; Gallimard (Folio, 1965), 1988
- « Solibo
magnifique », Paris : Gallimard,
1988 ; Gallimard (Folio, 2277), 1991
- « Antan d'enfance »,
Paris : Hatier, 1990 ; Gallimard (Haute enfance),
1994 ; Gallimard (Folio, 2843), 1996
- « Chemin-d'école »,
Paris : Gallimard (Haute enfance), 1994 ; Gallimard (Folio, 2844), 1996
- « Le
dernier coup de dent d'un voleur de banane » et
« Que faire de la parole ? Dans la
tracée
mystérieuse de l'oral à
l'écrit » in
Ralph Ludwig (éd.), Ecrire la « parole de
nuit », Paris :
Gallimard (Folio essais, 239), 1994
- « Ecrire
en pays dominé », Paris :
Gallimard, 1997 ; Gallimard (Folio, 3677), 2002
- « L'esclave
vieil homme et le molosse » avec un entre-dire
d'Edouard Glissant, Paris : Gallimard, 1997 ;
Gallimard (Folio, 3184), 1999
- « Livret
des villes du deuxième monde »,
Paris : Ed. du
Patrimoine (La Ville entière), 2002
- « Bibliques des derniers
gestes », Paris : Gallimard,
2001 ; Gallimard (Folio, 3942), 2003
- « A
bout d'enfance », Paris : Gallimard (Haute
enfance), 2005 ;
Gallimard (Folio, 4430), 2006
- « Un
dimanche au cachot », Paris : Gallimard,
2007 ; Gallimard (Folio, 4899), 2009
- « Les
neuf consciences du Malfini », Paris :
Gallimard, 2009 ; Gallimard (Folio, 5160), 2010
- « Le papillon et la
lumière », Paris :
Philippe Rey, 2011
- « L'empreinte
à Crusoé »,
Paris : Galliard, 2012 ; Gallimard (Folio, 5644), 2013
- « La matière
de l'absence », Paris : Seuil,
2016
- « Frères
migrants », Paris : Seuil, 2017
- « J'ai toujours
aimé la nuit », Paris :
Sonatine, 2017
- « Contes des sages
créoles », Paris :
Seuil, 2018
|
- « Eloge
de la créolité » avec Jean Bernabé
et Raphaël Confiant, Paris : Gallimard, 1989
- « Guyane :
traces-mémoires du bagne » photographies
de Rodolphe
Hammadi, Paris : CNMHS (Monuments en paroles), 1994
- « Elmire
des sept bonheurs : confidences d'un vieux travailleur de la
distillerie Saint-Etienne » photographies de
Jean-Luc de Laguarigue, Paris : Gallimard, 1998
- « Lettres créoles :
tracées antillaises et continentales de la
littérature 1635-1975 » avec
Raphaël Confiant, Paris : Hatier (Brèves,
Littérature), 1991 ; Paris : Gallimard
(Folio-essais, 352), 1999
- « Cases en
Pays-mêlés »
photographies de Jean-Luc de Laguarigue, Gros-Morne (Martinique), 2000
- « Tracées de
mélancolie » photographies de
Jean-Luc de Laguarigue, Gros-Morne (Martinique) : Traces HSE,
1999 ; Paris : Hazan, 2001
- « Trésors
cachés et patrimoine naturel de la Martinique vue du
ciel » photographies d'Anne Chopin, Paris :
HC
éditions, 2007
|
- Paola
Ghinelli, « Entretien avec Patrick
Chamoiseau », in Archipels
littéraires, Montréal :
Mémoire d'encrier, 2005
- Dominique
Chancé, « Patrick Chamoiseau,
écrivain
postcolonial et baroque », Paris :
Honoré
Chamion (Bibliothèque de littérature
générale et comparée,
82), 2010
- Samia
Kassab-Charfi, « Patrick
Chamoiseau », Paris : Institut
français, Gallimard, 2012
- Isabelle
Constant, « Le Robinson antillais : de
Daniel Defoe
à Patrick Chamoiseau », Paris :
L'Harmattan
(Espaces littéraires), 2015
|
| Sur le site « île en
île » : dossier Patrick Chamoiseau |
|
|
| mise-à-jour : 3
septembre 2021 |
| Patrick Chamoiseau, « Enrayer la violence en Corse »,
Libération, 27-28 novembre 1999 |
| Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant, « Dean est
passé, il faut renaître.
Aprézan ! »,
Le Monde, 26-27 août 2007 |
| Patrick Chamoiseau, « J'ai
vu un peuple s'ébrouer … »,
Le Monde, 14 mars 2009 |
| Patrick Chamoiseau, « Frantz Fanon,
côté sève »,
Le Monde, 11-12 décembre 2011 |
| Patrick Chamoiseau, « Aucune excuse,
aucune sanction, soutien total à M. Letchimy
», 10 février 2012 |
| Patrick Chamoiseau, « Le devenir, c'est
être ensemble, debout, face à l'impensable »,
Le Monde, 16 novembre 2013 |
| Patrick Chamoiseau, « Frères
migrants … Les poètes
déclarent »,
janvier 2017 |
|
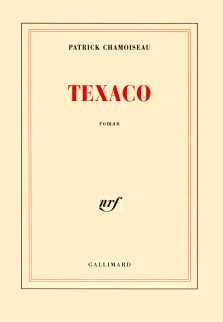
|
|
|
|