|
Vaudou
& compagnies : histoires noires de Abidjan à Zombies /
Jean-François Bizot. - Paris : Actuel, Éd. du
Panama, 2005. - 372 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 2-7557-0022-X
|
Jean-François
Bizot (1944-2007) se défiait des historiens — ceux
qui fabriquent l'histoire officielle qu'on retrouve dans les manuels
scolaires — autant que de la majorité des
journalistes professionnels. Au seuil d'une enquête sur l'Afrique
il ne manque pourtant pas de références, à
défaut de modèles, évoquant successivement le
Père Huc, Albert Londres, Hunter S. Thompson ou Jean Rouch. De quoi suggérer qu'il n'entend pas s'enliser sur des sentiers battus et rebattus.Or
quand il se rend en Haïti, rocher africain en mer Caraïbe,
c'est pour enquêter sur le Vaudou et les zombis
— thèmes de prédilection d'une certaine presse
prompte à stigmatiser le primitivisme d'un peuple
déliquescent ou matrice inépuisable pour les
réalisateurs de films d'horreur. Mais l'enquêteur reste
fidèle à l'ambition affichée dans une
préface exigente ; sans dissimuler la sympathie qu'il
éprouve envers ceux qu'il rencontre, sans rien renier de sa
propre personnalité, il s'efforce en multipliant les rencontres
de comprendre une réalité qui échappe aux
stéréotypes de la pensée occidentale.
Jean-François Bizot, écoute et enregistre, ne juge pas,
s'emporte parfois, ne renonce jamais à l'humour.C'était
en 1987, peu après la chute de Jean-Claude Duvalier :
« Je conseille de ne pas rater … le mois qui
suit les révolutions. On fait toutes sortes de rencontres quand
les coulisses sont dans la rue » (p. 226). Ces
circonstances ajoutent à l'intérêt d'un reportage
bref (pp. 226-257) mais incandescent.
|
| EXTRAIT |
Je
demande au jeune médecin les causes des maladies mentales en
Haïti. « Délire de persécution, peur du
sorcier, du voisin, épilepsie, schizophrénie,
malnutrition. La plupart des malades vous diront qu'un hougan leur a
jeté un sort. Mais ne condamnez pas le vaudou. Par quoi le
remplacer ? Dans les campagnes, le vaudou joue un rôle
social formidable. Pendant les cérémonies de possession,
les névrosés peuvent transférer leurs
délires sur les esprits. Le mysticisme sert de soupape. Quand
ça ne va pas, les gens vont d'abord voir le houngan. Si
ça ne marche pas et qu'ils sont catholiques, ils se
convertissent au protestantisme dans l'espoir de se rapprocher de la
protection divine. Je ne vois arriver que ceux qui ont
épuisé tous ces expédients.
Comprenez bien que le Haïtien a toujours supporté sa misère avec l'espoir des impuissants. On lui dit : Tout dépend de la récolte du café ou Attends la récolte de canne à sucre.
Quand la récolte n'est pas bonne, hop, c'est la bouffée
délirante et puis ça retombe au bout de quinze jours dans
l'attente séculaire. Cela dit, ça ne s'améliore
pas chez les jeunes qui ne vont plus chez les houngan. Cette
année, j'ai vu passer deux suicidés à cause d'un
échec au bac. » Paradoxe. Quand la magie s'envole, le
Haïtien ne rigole plus.
☐ pp. 238-239 |
|
|
COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE
d'autres éclairages sur le Vaudou
- Louis-Philippe Dalembert, « Vodou ! Un tambour pour les anges », Paris : Autrement, 2003
- Jacques Hainard, Philippe Mathez et Olivier Schinz (dir.), « Vodou », Gollion : Infolio, Genève : MEG, 2007
- Laënnec Hurbon, « Dieu dans le vaudou haïtien », Port-au-Prince : Éd. Henri Deschamps, 1987
- Laënnec Hurbon, « Les mystères du vaudou », Paris : Gallimard (Découvertes, 190), 2000
- R.P. Carl-Edward Peters, « La Croix contre l'Asson », Port-au-Prince : Imprimerie La Phalange, 1960
- Jacques Roumain, « A propos de la campagne antisuperstitieuse », Port-au-Prince : Imprimerie de l'Etat, 1942
|
|
| mise-à-jour : 31 juillet 2010 |
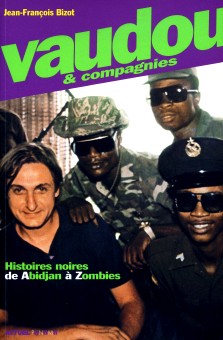
| |
|