|
La Littérature
antillaise entre histoire et mémoire, 1935-1995 / Albert
James
Arnold. - Paris : Classiques Garnier, 2020. -
354 p. ;
22 cm. - (Bibliothèque francophone, 9).
ISBN
978-2-406-09149-3
|
|
L'histoire
rassemble,
la
mémoire divise.
☐ Pierre Nora, cité
en épigraphe au 1er chapitre de la 2ème partie,
p. 81 |
Écrit
dans la foulée d'un large panorama des
littératures de la
Caraïbe (1), cet
ouvrage examine la littérature
antillaise
francophone (Guadeloupe, Martinique) qu'il situe et
caractérise
par rapport aux littératures voisines (anglophones,
hispanophones et néerlandophones) et suit dans son
évolution
au cours d'un demi-siècle marqué
— à ses
débuts (1935) par l'affirmation de la négritude
— à son terme (1995) par
l'émergence et la consécration de la créolité.
Dans
ce cadre comparatiste et historique, Albert James Arnold expose et
développe l'idée selon laquelle le principal
ressort
d'évolution de la littérature aux Antilles
francophones
serait tributaire du statut politique et social des deux
îles : colonies hier, départements depuis
1946, régions
mono-départementales depuis 1982. Cette
évolution — subie ?
consentie ? — a pour conséquence
“ une
conscience malheureuse qui vit difficilement l'incorporation de la
société antillaise aux institutions de la France
métropolitaine ”
(p. 10). En
référence aux travaux de Pierre Nora, l'auteur
pose alors
le diagnostic d'un conflit fondamental entre
“ histoire ” et “
mémoire ” qui, sous des formes variables,
traverse la
période analysée et devrait, selon toute
probabilité, persister : “ le
devoir de mémoire a de beaux jours devant lui, la division
des
ethnoclasses servant à l'entretenir et à
préserver
les conflits historiques sans espoir de
résolution ” (p. 318).
Rigoureusement
appuyée sur une connaissance approfondie de la
littérature des îles, l'ouvrage de l'universitaire
américain propose un parcours original et stimulant. On peut
cependant regretter qu'il sous-estime la capacité de la
littérature à transcender, sans les ignorer, les
contingences historiques, sociales ou politiques
— Césaire ou Glissant peuvent rencontrer
Saint-John Perse au-delà de tout ce qui distingue les ethno-classes
auxquelles ils appartiennent de fait. Enfin les très
pertinentes
questions que posent l'ouvrage sont parfois banalisées par
le
ton péremptoire et réducteur de certaines
réponses.
| (1) |
Albert James Arnold (ed.), « A
history of literature in the Caribbean » 3 volumes ,
1994-2001 |
|
SOMMAIRE
(résumé) |
Introduction
Première partie
FORMATION
DE L'IMAGINAIRE ANTILLAIS
Prologue
Questions de méthode
À
l'époque du Code
Noir
Le Flibustier tous
azimuts
Une scène
fondatrice du discours identitaire : la Pariade
Institutionalisation
de la mémoire
De la violence
De la créolisation
De l'Apocalypse et de
la “ révolution ”
Des
géographies imaginaires et des images persistantes
De la
Révolution de Saint-Domingue
De Toussaint
Louverture : une figure emblématique
Deuxième partie
ÉLÉMENTS
DU DILEMME
De l'institution littéraire et du détournement
mémoriel
Le Saint-Pierre de Lafcadio Hearn : un lieu de
mémoire paradoxal
De la supercherie et
de “ l'authenticité ”
Fanon chez l'Oncle Sam
: des révolutionnaires noirs aux féministes
blanches
Un roman colonial au
service du féminisme anglo-américain
Langue et géographie devant l'histoire et la
mémoire
Langue créole, langue
française
Variations sur le
conte créole
Géographie
symbolique et Imaginaire
Troisième partie
SORTIR
DE L'IMPASSE ?
Négritude, créolité,
créolisation
Négritude : d'une Afrique utopique
à l'Afrique décoloniale
La
créolité : théorie et pratique
Points d'appui
historiques
Vers la
créolisation
Vers une créolisation au féminin en Guadeloupe
Deux faces d'une même culture ?
L'illusion de la
racine unique
Une vision diasporique
La
réécriture de la culture dominante
Une
créoliste guadeloupéenne :
Gisèle Pineau
Vers une
créolisation par le bas : Dany Bébel-Gisler
Épilogue
Bibliographie (pp. 319-341)
Index |
|
| EXTRAIT |
L'idée
de réécrire l'histoire littéraire du
point de vue
de l'ex-colonisé remonte aux années 1950 dans la
Caraïbe. Lié à la lutte pour
l'indépendance
dans les îles anglophones, la
réécriture aux
Antilles Françaises devait nécessairement
interroger la
mue récente des colonies en départements
d'outre-mer.
Dans “ L'Appel ” et
” Le
Voyage ” des Indes, 1955,
Glissant a campé un Christophe Colomb face au destin futur
des
Indes Occidentales. Son écriture rappelle, à ce
stade de
son évolution poétique, celle de Saint-John
Perse, le
maître de l'épopée en
français
à cette date. Le jeune Glissant devait se mesurer
à
l'illustre représentant de l'impérialisme afin de
trouver
sa voix et son attitude propre. Sur l'île voisine
à la
même époque, le Saint-Lucien Derek Walcott a
dû se
libérer du poids écrasant de T.S. Eliot dans un
effort
pour “ élargir les paramètres
de la
tradition ”. Un certain nombre de figures
littéraires
illustres se sont rapidement dégagées pour leur
lien
— réel ou imaginaire —
avec la
Caraïbe. Si Christophe Colomb revient fréquemment
comme
symbole de la conquête qui a rapidement suivi la
découverte des Amériques par l'Europe, c'est
Caliban qui
a tenu le haut du pavé pendant un demi-siècle. Du
Guyanais ex-britannique G. Lamming au Martiniquais A.
Césaire,
en passant par le Cubain Fernández Retamar,
l'écrivain
caribéen s'est souvent situé par rapport
à La Tempête
de Shakespeare afin d'articuler sa revanche sur la culture de la
puissance dominante (1). Vers le milieu des années 1980,
Maryse
Condé a rejoint cette tradition, dans le monde anglophone et
surtout dans la littérature en simili (2) des cours
universitaires.
☐
Troisième Partie, La
réécriture de la culture dominante, p. 287
| (1) |
- George
Lamming, « The pleasures of
exile », London : Michael Joseph, 1960
- Aimé
Césaire, « Une tempête »,
Paris : Seuil, 1969
- Roberto
Fernández Retamar,
« Calibán : apuntes
sobre la cultura en nuestra América »,
México : Ed. Diógenes, 1971
- Maryse
Condé (dir.), « L'héritage de
Caliban », Pointe-à-Pitre :
Jasor, 1992
|
| (2) |
Littérature en simili :
notion présentée et illustrée par
Pierre Bourdieu
; cf. “ Le marché des biens
symboliques ”, L'Année
sociologique, t. 3,
n° 22, 1971 |
|
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- Albert James
Arnold (ed.), « A
history of literature in the Caribbean, Vol. 1 :
Hispanic and
francophone regions », Amsterdam,
Philadelphia : John
Benjamin, 1994
- Albert James
Arnold
(ed.), « A history of literature in the Caribbean,
Vol. 2 : English and Dutch-speaking
regions »,
Amsterdam, Philadelphia : John Benjamin, 2001
- Albert
James Arnold (ed.), « A history of literature in the
Caribbean, Vol. 3 : Cross-cultural
studies »,
Amsterdam, Philadelphia : John Benjamin, 1997
- Albert
James Arnold (dir.), « Aux quatre vents de la
Caraïbe », Paris : Les
Éd. de Minuit
(Critique, 711-712), 2006
- Albert
James Arnold, « Aimé
Césaire :
genèse et transformations d'une
poétique »,
Würzburg : Königshausen & Neumann,
2020
|
- Aimé
Césaire,
« Poésie,
théâtre, essais et
discours » éd. critique sous la
dir. de Albert James
Arnold, Paris : CNRS éditions, Présence
africaine (Planète
libre, 4), 2013
- Aimé
Césaire, « The complete poetry of
Aimé
Césaire » bilingual edition translated by
A. James
Arnold and Clayton Eshleman, Middletown (Connecticut) :
Wesleyan
university press, 2017
|
|
|
| mise-à-jour : 23
février 2021 |
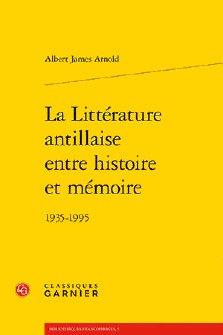 |
|
|
|