|
Ainsi parla l'Oncle (Essais
d'ethnographie) / Jean Price-Mars ; introduction de Roger
Gaillard. - Port-au-Prince : Imprimeur II, 1998. -
XXVIII-224 p. : ill. ; 23 cm.
|
|
PATRICK
CHAMOISEAU et RAPHAËL CONFIANT :
[…] Haïti, malgré
l'indépendance, n'a pu développer
immédiatement à l'écrit sa langue
vernaculaire, alors que dans les territoires comme la Martinique, la
Guadeloupe ou la Guyane, de toute éternité sous
obédience française, on trouve des textes en
créole dès le milieu du XIXe
siècle. Toujours est-il que c'est contre ce tropisme
français, ce “ bovarysme
collectif ” haïtien, selon sa propre
expression, que s'insurgera en 1928 Jean Price-Mars (1876-1969) dans Ainsi
parla l'Oncle. Cet ouvrage est annonciateur d'une nouvelle
tracée des lettres créoles. Price-Mars demandera
aux écrivains de se pencher sur la culture populaire, les
contes créoles et le vaudou, tout en émettant
quelques doutes, il est vrai, sur la capacité du
créole à devenir une langue de plein exercice.
Pour lui Haïti ne saurait demeurer une variante exotique de la
France : la littérature haïtienne,
inscrite en plein cœur d'Haïti, se doit de devenir
majeure.
☐
« Lettres
créoles : tracées antillaises et
continentales de la littérature, 1635-1975 »,
p. 88
|
|
MAXIMILIEN
LAROCHE :
On peut faire remonter à Ainsi parla l'oncle
(1928) le début de l'appropriation de l'imaginaire populaire
par les écrivains haïtiens. C'est le docteur
Price-Mars en effet qui mit le vodoun à la mode, d'abord en
le présentant comme une religion à part
entière et ensuite en recommandant aux écrivains
d'aller puiser leur inspiration dans le trésor de
légendes, de contes et de croyances alimenté par
l'imagination populaire. Et cela, ne l'oublions pas, en faisant honte
à l'élite haïtienne de se
reconnaître plus volontiers esquimaude, samoyède
ou toungouze que guinéenne ou soudanaise.
Il en résulta non
seulement une réhabilitation de l'Afrique et du vodoun mais
une utilisation systématique de la crise de possession
vodouesque comme scène emblématique de la culture
haïtienne.
☐
« Imaginaire
populaire et littérature : Le houngan, le zombi et
le mécréant », Notre
Librairie, n° 133,
janvier-avril 1998
|
|
ANNE
MARTY :
Cet ouvrage analyse toutes les composantes de la
réalité haïtienne sur les plans social,
ethnique, anthropologique et philosophique (bourgeoise,
européenne, rurale ou africaine). En conciliant des
données, considérées jusque
là comme contradictoires, il rassure tout le monde, y
compris les élites. Par une démarche rationnelle
et scientifique, il tente d'éradiquer la honte
inhérente à la perception qu'à
l'époque on peut avoir du monde rural et africain. Et en
cela sa démarche est très progressiste. Cette
“ irruption de l'imaginaire populaire dans l'espace
politique ” constitue une démarche
identitaire qui s'exprime pour la première fois sur un mode
aussi distancié. L'auteur fait preuve ainsi d'une grande
sagesse sur le plan philosophique. Aussi a-t-il
été considéré par tous
comme un véritable maître.
☐
« Haïti en
littérature », p. 37
|
|
JEAN
PRICE-MARS
: Nous avons
longtemps nourri l'ambition de relever aux yeux du peuple
haïtien la valeur de son folk-lore. Toute la
matière de ce livre n'est qu'une tentative
d'intégrer la pensée populaire haïtienne
dans la discipline de l'ethnographie traditionnelle.
[…]
Mais, nous dira-t-on, à quoi bon se
donner tant de peine à propos de menus problèmes
qui n'intéressent qu'une très infime
minorité d'hommes, habitant une très infime
partie de la surface terrestre ?
On a peut-être raison.
Nous nous permettrons d'objecter cependant que ni
l'exiguité de notre territoire, ni la faiblesse
numérique de notre peuple ne sont motifs suffisants pour que
les problèmes qui mettent en cause le comportement d'un
groupe d'hommes soient indifférents au reste de
l'humanité. En outre, notre présence sur un point
de cet archipel américain que nous avons
“ humanisé ”, la
trouée que nous avons faite dans le processus des
événements historiques pour agripper notre place
parmi les hommes, notre façon d'utiliser les lois de
l'imitation pour essayer de nous faire une âme d'emprunt, la
déviation pathologique que nous avons infligée au
bovarysme des collectivités en nous concevant autres que
nous ne sommes, l'incertitude tragique qu'une telle démarche
imprime à notre évolution au moment où
les impérialismes de tous ordres camouflent leurs
convoitises sous des dehors de philantropie, tout cela donne un certain
relief à l'existence de la communauté
haïtienne et, devant que la nuit vienne, il n'est pas inutile
de recueillir les faits de notre vie sociale, de fixer les gestes, les
attitudes de notre peuple, de scruter leurs origines et de les situer
dans la vie générale de l'homme sur la
planète. Ils sont des témoins dont la
déposition ne peut être négligeable
pour juger la valeur d'une partie de l'espèce humaine.
Tel est,
en dernière analyse, le sens de notre entreprise, et quelque
soit l'accueil qu'on lui réserve, nous voulons qu'on sache
que nous ne sommes pas dupes de son insuffisance et de sa
précarité. —
Pétionville,
le 15 décembre 1927
☐
Préface, pp. XXXVII-XXXIX
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Ainsi
parla l'Oncle : essais d'ethnographie
haïtienne »,
Compiègne : Imprimerie de Compiègne, 1928
- « Ainsi
parla l'Oncle », New York : Parapsychology
foundation, 1954
- « Ainsi
parla l'Oncle », Montréal :
Leméac (Caraïbes), 1973, 1979
- « Ainsi
parla l'Oncle, essais d'ethnographie » (reprod. en
fac-sim.
de l'éd. de, New York : Parapsychology foundation,
1954),
Port-au-Prince : Fardin, 1998
- « Ainsi parla l'Oncle (suivi de)
Revisiter l'Oncle »,
Montréal : Mémoire d'encrier (Essais),
2009
|
→
René Depestre, « Jean Price-Mars et le
mythe de
l'Orphée noir ou les aventures de la
négritude », L'Homme et la
société, 7, 1968, pp. 171-181 [en
ligne]
|
| Sur
le site « île
en île » :
dossier Jean Price-Mars |
|
|
| mise-à-jour : 15
mai 2019 |
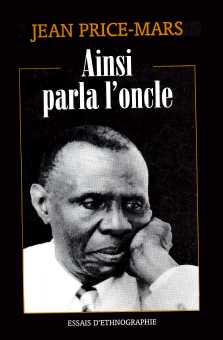
|
|
|
|
|
|