|
Etudes
philosophiques : Massimilla Doni / Balzac ;
éd.
établie sous la dir. de Claude Blum et Didier Alexandre ;
introduction par Andrea Del Lungo. - Paris : Garnier, Le Monde, 2008. -
509 p. ; 18 cm. - (La Comédie humaine, 6).
ISBN
978-2-35184-022-1
|
|
Ne
demandez pas s'ils s'aimaient. Ils s'aimaient trop.
☐ p. 434 |
Fruit d'une longue maturation, Massimilla
Doni paraît dans sa forme définitive
en 1839 et trouve sa place dans les Etudes philosophiques,
comme La peau de chagrin
ou Le
chef-d'œuvre inconnu.
Mais résumer l'intrigue expose au risque de
dénoncer un
vaudeville, né d'un banal quiproquo et promis à
un
dénouement « horriblement
bourgeois »
(p. 509). Toutefois ces artifices s'accordent au lieu et au
contexte historique.
En
1820, Venise est depuis quatre ans sous administration autrichienne.
C'est là que Balzac poursuit son exploration des ressorts de
la
quête d'absolu, dans l'aspiration à un amour
hautement
idéalisé pour les uns, dans le sublime d'une
interprétation musicale pour d'autres, dans la
rêverie
opiomane pour un dernier. Pour tous au risque de la vie.
Ces
aspirations s'expriment à leur paroxysme dans une loge de la
Fenice pendant une représentation du Moïse
de Rossini. La tension est exaltée par la ferveur
patriotique
qui s'empare de tous : « Moïse est
le
libérateur d'un peuple esclave ! (…)
vous verrez
avec quel religieux espoir la Fenice tout entière
écoutera la prière des Hébreux
délivrés, et par quel tonnerre d'applaudissements
elle y
répondra ! » (p. 477).
Passé ce vif
accès de patriotisme, les passions s'apaisent,
jusqu'à
l'heureux dénouement dénoncé, comme
à
regret, par l'auteur ; seul le fumeur d'opium
connaît une
triste fin : « l'amour d'une patrie qui
n'existe plus
est une passion sans remède »
(p. 509).
|
| EXTRAIT |
Le
prince prit un nouveau cigare et contempla les arabesques de sa
fumée livrée au vent, comme pour voir dans leurs
caprices
une répétition de sa dernière
pensée. De
loin, il distinguait déjà les pointes moresques
des
ornements qui couronnaient son palais : il redevint triste. La
gondole de la duchesse avait disparu dans le Canareggio. Les fantaisies
d'une vie romanesque et périlleuse, prise comme
dénouement de son amour, s'éteignirent avec son
cigare,
et la gondole de son amie ne lui marqua plus son chemin. Il vit alors
le présent tel qu'il était : un palais
sans
âme, une âme sans action sur le corps, une
principauté sans argent, un corps vide et un cœur
plein,
mille antithèses désespérantes.
L'infortuné
pleurait sa vieille Venise, comme la pleurait plus amèrement
encore Vendramini, car une mutuelle et profonde douleur et un
même sort avaient engendré une mutuelle et vive
amitié entre ces deux jeunes gens, débris de deux
illustres familles. Émilio ne put s'empêcher de
penser aux
jours où le palais Memmi vomissait la lumière par
toutes
ses fenêtres et retentissait de musiques portées
au loin
sur l'onde adriatique ; où l'on voyait à
ses poteaux
des centaines de gondoles attachées, où l'on
entendait
sur son perron baisé par les flots les masques
élégants et les dignitaires de la
République se
pressant en foule ; où ses salons et sa galerie
étaient enrichis par une assemblée
intriguée et
intriguant ; où la grande salle des festins,
meublée
de tables rieuses, et ses galeries au pourtour aérien,
pleines
de musique, semblaient contenir Venise entière allant et
venant
sur les escaliers retentissants de rires. Le ciseau des meilleurs
artistes avait, de siècle en siècle,
sculpté le
bronze, qui supportait alors les vases au long col ou ventrus
achetés en Chine, et celui des candélabres aux
mille
bougies. Chaque pays avait fourni sa part du luxe qui parait les
murailles et les plafonds. Aujourd’hui, les murs
dépouillés de leurs belles étoffes,
les plafonds
mornes se taisaient et pleuraient. Plus de tapis de Turquie, plus de
lustres festonnés de fleurs, plus de statues, plus de
tableaux,
plus de joie ni d’argent, ce grand véhicule de la
joie ! Venise, cette Londres du Moyen Âge, tombait
pierre
à pierre, homme à homme. La sinistre verdure que
la mer
entretient et caresse au bas des palais était alors aux yeux
du
prince comme une frange noire que la nature y attachait en signe de
mort. Enfin, un grand poète anglais était venu
s’abattre sur Venise comme un corbeau sur un cadavre, pour
lui
coasser en poésie lyrique, dans ce premier et dernier
langage
des sociétés, les stances d’un De
Profundis !
De la poésie anglaise jetée au front
d’une ville
qui avait enfanté la poésie
italienne ! … Pauvre Venise !
☐ pp. 440-441 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « Une
fille d'Eve [suivi de] Massimilla Doni »,
Paris : Hippolyte Souverain, 1839
- « Massimilla
Doni », in Etudes
philosophiques, tome II, Paris : Furne,
1846
|
- « Massimilla
Doni » éd.
présentée par Max Milner,
Paris : José Corti, 1964
- « Le
chef-d'œuvre inconnu ; Gambara ; Massimilla
Doni
» éd. par Marc Eigeldinger et Max Milner,
Paris :
Flammarion (GF, 365), 1981
- « Sarrasine ;
Gambara ; Massimilla Doni » éd.
par Pierre Brunel, Paris : Gallimard (Folio classique, 2817), 2007
|
- « La duchesse de Langeais »
in Scènes de
la vie parisienne, Paris : Le Monde, Classiques
Garnier (La Comédie humaine, 8), 2008
|
|
|
| mise-à-jour : 26
septembre 2012 |
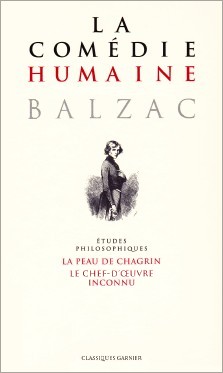 |
|
|
|