|
Les
mensonges de la mer / Nashiki Kaho ; trad. du japonais par
Corinne
Quentin. - Arles : Philippe Picquier, 2017. -
195 p. ;
21 cm.
ISBN 978-2-8097-1252-0
|
|
NOTE
DE L'ÉDITEUR :
Au début des années 1930, un jeune chercheur en
géographie humaine se rend dans une île
isolée au
sud de Kyūshū.
Une île petite et dense comme
un bonsaï (1) où, entre mer et montagne, il chemine dans la
forêt de brume ou les villages accrochés aux
pentes
abruptes, attentif à la moindre rencontre, animaux, fleurs
ou
humains. Il cherche les ruines d'un immense monastère
bouddhiste, recueille les croyances anciennes, mène de
longues
conversations avec un ancien marin retiré au milieu de la
forêt. C'est un monde où le temps semble
s'être
arrêté, dont la
sérénité est
cependant rompue par les traces des violentes destructions qui l'ont
jadis traversé.
Ce roman à l'écriture
limpide nous transmet une forme de tranquillité,
à la
recherche de l'accord secret entre une terre et la vie qui l'anime, du
lien spirituel qui nous unit à la nature et à la
mémoire.
| ❙ | NASHIKI
Kaho, née en 1959 à Kagoshima dans le Kyūshū,
écrit pour la jeunesse et pour les adultes. Son
intérêt pour l'histoire des religions, sa connaissance des
plantes, son goût pour les voyages alimentent ses écrits,
romans, essais, récits de voyage … Elle a
reçu de nombreux prix littéraires, notamment pour Nishi no majo ga shinda (La sorcière de l’est est morte) également adapté au cinéma. Un album illustré dont elle a signé le texte, Le peintre, est paru en France (éditions nobi nobi !, 2014). | | |
| 1. |
« Une
île, ce fut la forte impression que j'eus au début
de mon
séjour, est comme un bonsaï. Non parce qu'elle est
modelée par l'homme. Plutôt parce qu'elle
déborde
d'une vitalité qui ne cesse d'exploser. »
— Les
mensonges de la mer, p. 15. |
|
|
En
cheminant d'une extrémité à l'autre de
l'île
(fictive) d'Osojima, au Sud de Kyūshū, le narrateur
prend
la mesure moins des lieux — quelques jours de marche
suffisent pour se rendre d'un extrême à
l'autre — que du temps et de son passage
dont
témoignent des ruines laissées à
l'écart et
des histoires voilées de silence. On devine en
arrière-plan le rude conflit opposant shintō et
bouddhisme pendant l'ère Meiji ; on s'interroge sur
l'évolution de l'habitat insulaire à la
croisée d'influences venues du nord et du sud
— mais
l'élan conquérant ? les forces de
résistance ? la capacité de
synthèse ?
Ces
questions, et d'autres, demeurent sans réponse quand le
narrateur quitte l'île, bien décidé
à
revenir pour reprendre son enquête. Mais survient la guerre,
puis
le mariage et les contraintes d'une carrière universitaire.
Cinquante ans plus tard … le hasard permet de
renouer le
fil. Un pont unit l'île à la grande terre proche,
la plus
haute montagne a été écimée
pour
fournir la pierre nécessaire à d'ambitieux
projets
touristiques. Face à l'ampleur du bouleversement, les
interrogations d'hier pourraient avoir perdu toute pertinence. C'est
pourtant à cet instant précis qu'un
phénomène naturel, un instant de vacillement des
apparences — les
mensonges de la mer —, impose
paradoxalement l'idée d'une sereine et rassurante permanence.
|
| EXTRAIT |
Mon
regard quitta les verts feuillages et se tourna vers la mer. A ce
moment, quelque chose qui m'était familier entra dans mon
champ
de vision.
— Yûji, regarde
ça !
—
Quoi donc ? Ah, les mirages ?
—
Oui. Certains les appellent les mensonges de la mer.
—
C'est vrai, j'ai entendu dire que des mirages se produisaient. Moi, je
n'ai pas le temps de regarder tranquillement la mer, c'est la
première fois que j'en vois. Ils étaient
là depuis
quand ? Tout à l'heure il n'y en avait pas, il me
semble ?
Les
rayons du soleil d'été, se reflétaient
sur l'eau
éblouissante dans ce décor vacillant, une
superposition
de murs blancs s'étirait vers l'horizon ; ainsi que
M.
Yamané le disait, c'était comme ces remparts qui
apparaissent soudain dans le désert.
—
Que c'est beau ! murmura Yûji. Il semblait ne pas
pouvoir
contenir son émotion. Comme frappé par surprise,
j'eus la
sensation qu'une lame acérée atteignait le plus
profond
de ma poitrine. Ce phénomène, même si
je le
trouvais intéressant, je ne lui aurais jamais
donné ce
qualificatif de
« beau » ;
jusqu'à
présent, dans ma vie, je n'avais jamais regardé
les
choses avec ce que je pourrais appeler « un regard
d'enfant ». Je fixai intensément la mer.
Umi-uso, les
mirages de la mer. Cette chose-là, au moins,
était telle
qu'autrefois. Si je l'avais pu, j'aurais voulu m'accrocher à
cette « permanence » et laisser
mes cris et mes
pleurs exploser sans la moindre retenue. En même temps, je me
rappelai ce qu'autrefois M. Yamané avait
murmuré. « Voir des mirages
depuis ici
était la plus grande joie de mon
père ».
☐ pp. 191-192 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « 海うそ (Umiuso)
», Tōkyō : Iwanami Shoten, 2014
- « Les mensonges de la mer », Arles : Picquier (Picquier poche), 2019
|
|
|
| mise-à-jour : 19 janvier 2022 |
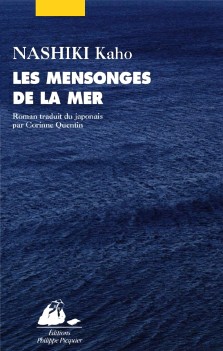
|
|
|
|