|
Histoire et utopie / Cioran. -
Paris : Gallimard, 1992. - 147 p. ;
18 cm. - (Folio, Essais, 53).
ISBN
2-07-032407-9
|
|
L'utopie
est une mixture de rationalisme puéril et
d'angélisme sécularisé.
☐ Mécanisme de
l'utopie, p. 111 |
Les deux
derniers chapitres de cet essai examinent la
pensée utopique telle qu'elle s'est
développée
depuis l'antiquité. Le constat est sans concession.
Régressive — nostalgique d'un âge d'or
immémorial, comme
antérieur au devenir — ou tendue vers le futur — obnubilée par le
« progrès » —,
la rêverie utopique mène au mieux à une
impasse, quand elle ne précipite pas la chute.
L'examen
critique ne ménage aucune des grandes figures de la
pensée utopique, More, Campanella et Platon leur
précurseur — « l'ancêtre … de
toutes ces aberrations » ; la
charge n'est pas moins rude contre les penseurs du XIXe
siècle, Etienne Cabet tout particulièrement.
Entre les premiers et le dernier, seul Swift surnage : « par ses
sarcasmes, (il) a déniaisé (le) genre au point de
l'anéantir ».
Le dernier
chapitre introduit Dostoïevski qui dans, La confession de Stavroguine — fragment
publié tardivement des Possédés —
puis dans L'adolescent,
offre une vision sublimée de l'âge d'or,
inspirée par la découverte à Dresde
d'un tableau
de Claude Lorrain ; mais c'est pour mieux en souligner la précarité
et l'inéluctable sacrifice.
Aussi
fragiles ou dangereux soient-ils, les paradis perdus ou les utopies
à construire témoignent pourtant d'un
violent rejet du monde
tel qu'il est. Cioran partage ce jugement, et suggère un
détour exigeant : « Inutile
de remonter vers le paradis ancien ou de courir vers le
futur :
l'un est est inaccessible, l'autre irréalisable. Ce qui
importe
en revanche c'est d'intérioriser la nostalgie ou
l'attente … et de les contraindre à
déceler,
ou à créer en nous le bonheur que respectivement
nous
regrettons ou nous escomptons. Point de paradis, sinon au plus profond
de notre être … »
(p. 147).
|
| EXTRAITS |
Les
rêves de l'utopie se sont pour la plupart
réalisés,
mais dans un esprit tout différent de celui où
elle les
avait conçus ; ce qui pour elle était
était
perfection est pour nous tare ; ses chimères sont
nos
malheurs. Le type de société qu'elle imagine sur
un ton
lyrique nous apparaît, à l'usage,
intolérable.
Qu'on en juge par l'échantillon suivant du Voyage en Icarie :
« Deux mille cinq cents jeunes femmes (des modistes)
travaillent
dans un atelier les unes assises, les autres debout, presque toutes
charmantes … L'habitude qu'a chaque
ouvrière de
faire la même chose double encore la rapidité du
travail
en y joignant la perfection. Les plus élégantes
parures
de tête naissent par milliers chaque matin enre les mains de
leurs jolies
créatrices … » —
Pareilles élucubrations relèvent de la
débilité mentale ou du mauvais goût. Et
pourtant
Cabet a, matériellement, vu juste ; il ne s'est
trompé que sur l'essentiel. Nullement instruit de
l'intervalle
qui sépare être
et produire (nous
n'existons, au sens plein du mot, qu'en dehors de ce que nous faisons,
qu'au-delà de nos actes), il ne pouvait déceler
la
fatalité attachée à toute forme de
travail,
artisanale, industrielle ou autre. La chose qui frappe le plus dans les
récits utopiques, c'est l'absence de flair,
d'instinct
psychologique. Les personnage en sont des automates, des fictions ou
des symboles : aucun n'est vrai, aucun ne dépasse
sa
condition de fantoche, d'idée perdue au milieu d'un univers
sans
repères.
☐ Mécanisme de
l'utopie, pp. 108-109 |
Tant que le christianisme comblait les esprits, l'utopie ne
pouvait les séduire ; dès qu'il
commença
à les décevoir, elle chercha à les
conquérir et à s'y installer. Elle s'y employait
déjà à la Renaissance, mais ne devait
y
réussir que deux siècles plus tard, à
une
époque de superstitions
« éclairées ».
Ainsi naquit
l'Avenir, vision d'un bonheur irrévocable, d'un paradis
dirigé, où le hasard n'a pas de place,
où la
moindre fantaisie apparaît comme une
hérésie ou une
provocation. En faire la description, ce serait entrer dans les
détails de l'inimaginable. L'idée même
d'une
cité idéale est une souffrance pour la raison,
une
entreprise qui honore le cœur et disqualifie l'intellect.
(Comment un Platon y put-il condescendre ? Il est
l'ancêtre,
j'allais l'oublier, de toutes ces aberrations, reprises et
aggravées par Thomas Morus, le fondateur des
illusions modernes.) Échaffauder une
société
où, selon une étiquette terrifiante, nos actes
sont
catalogués et réglés, où,
par une
charité poussée jusqu'à
l'indécence, l'on
se penche sur nos arrière-pensées
elles-mêmes,
c'est transposer les affres de l'enfer dans l'âge d'or, ou
créer, avec le concours du diable, une institution
philanthropique. Solariens, Utopiens, Harmoniens
— leurs
noms affreux ressemblent à leur sort, cauchemar qui nous est
promis à nous aussi, puisque nous l'avons
noux-même
érigé en idéal.
☐ Mécanisme de
l'utopie, pp. 114-115 |
|
|
| COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE | - « Histoire
et utopie », Paris : Gallimard (Les Essais, 96),
1960
- « Histoire et utopie » in Œuvres, Paris :
Gallimard (La
Pléiade, 574), 2011
| |
|
|
| mise-à-jour : 8
avril 2014 |
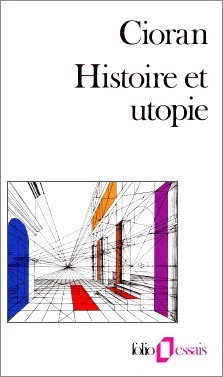
|
|
|
|