|
Albertine
disparue / Marcel Proust ; édition
établie par
Nathalie Mauriac et Etienne Wolf. - Paris : Grasset, 1987. -
223 p.-4 f. de fac-sim. dépl. ;
20 cm.
ISBN
2-246-39731-6
|
Quand
paraît la première édition d'Albertine disparue
en 1925, Marcel Proust est mort depuis trois ans. Le texte remis
à la Nouvelle Revue Française porte la marque de
Robert
Proust, frère de l'auteur, qui a
déchiffré et
ordonné les éléments d'un manuscrit
profus et
labyrinthique en s'efforçant de respecter l'idée
qu'il se
formait de la continuité de l'œuvre au long cours
où le volume prenait sa place. Cette mise en forme a servi
de
base aux nombreuses rééditions qui se sont
suivies
pendant plus d'une soixantaine d'années.
Découvert en
1986, un nouvel état du texte, établi par
l'auteur
quelques semaines avant sa mort en novembre 1922, a remis en question
ces choix éditoriaux ; publié en 1987
par Nathalie
Mauriac et Etienne Wolf, il a suscité de nombreux et parfois
vifs débats et ouvert la voie à de nouvelles
éditions qui infléchissent la portée
de
l'œuvre ou, pour le moins, élargissent le champ
des
interrogations.
Le volume publié en
1987 sous le
titre “ Albertine disparue
— édition
originale de la dernière version revue par
l'auteur ”
est composé de deux chapitres ; au premier, le
narrateur
expose le débat intérieur qu'entraîne
la fuite
d'Albertine puis la tourmente causée par la nouvelle de sa
mort
accidentelle : “ Pour me consoler, ce n'est
pas une,
c'est d'innombrables Albertine que j'aurais dû oublier. Quand
j'étais arrivé à supporter le chagrin
d'avoir
perdu celle-ci, c'était à recommencer avec une
autre,
avec cent autres ” (p. 114). Le second
chapitre relate
un voyage à
Venise — “ Ma
mère
m'avait emmené passer quelques semaines à
Venise … ”
(p. 127) — qui occupe
une trentaine de pages, sensiblement moins que dans les
éditions
fondées sur le texte publié en 1925. On
relève,
pour tenter d'expliquer ce resserrement, la suppression de redites 1 ;
on peut également supposer que l'auteur s'est
attaché
à maîtriser plus rigoureusement la mise en
perspective
d'une visée globale en ménageant l'effet de
surprise
à venir aux ultimes pages de l'œuvre 2.
Mais l'essentiel repose sur l'absence presque totale de
référence au souvenir d'Albertine.
En
comparaison avec le texte plus développé sinon
plus riche
des éditions antérieures, l'édition de
1987 fait
figure d'épure où Venise occupe le premier plan
— Venise dans le regard du narrateur, soit une
Venise
presque familière : “ j'y
goûtais des
impressions analogues à celles que j'avais si souvent
ressenties
autrefois à Combray ” (p. 127),
“ Venise où la vie quotidienne
n'était pas
moins réelle qu'à Combray ”
(p. 128).
Mais pour être entré de plain pied dans la
Cité des
Doges, le narrateur n'en est pas moins sensible aux
possibilités
d'évasion que suggèrent le caractère
oriental de
l'architecture, la lumière et les
couleurs : ” Ma gondole suivait
les petits canaux ;
comme la main
mystérieuse d'un génie qui m'aurait conduit dans
les
détours de cette ville
d'Orient … ”
(p. 132). C'est enfin, l'omniprésence de
l'élément marin qui s'impose
progressivement : “ Venise où
les simples allées
et venues
mondaines prennent en même temps la forme et le charme d'une
visite à un musée et d'une bordée en
mer ” (p. 134).
A la fin du chapitre l'emprise
du monde aquatique et l'imminence d'un départ
précipité suscitent l'émergence d'un
éprouvant souvenir d'enfance :
“ ce bassin de
l'arsenal à la fois insignifiant et lointain me remplissait
de
ce mélange de dégoût et d'effroi que
j'avais
éprouvé tout enfant (…) aux bains
Deligny ;
en effet dans le site fantastique composé par une eau sombre
que
ne couvraient pas le ciel ni le soleil (…) je
m'étais demandé si ces profondeurs (…)
n'étaient pas l'entrée des mers glaciales qui
commençaient là, si les pôles n'y
étaient
pas compris et si cet étroit espace n'était pas
précisément la mer libre du
pôle ; cette
Venise irréelle sans sympathie pour moi (…) ne me
semblait pas moins isolée, moins irréelle, et
c'était ma détresse que le chant de Sole mio, s'élevant
comme une déploration de la Venise que j'avais connue,
semblait
prendre à témoin ”
(p. 154). Au terme de
ce qui s'apparente à une descente aux Enfers, le narrateur
est
prêt à reprendre son chemin, seul
— Albertine
irrévocablement disparue.
| 1. |
Dans
les éditions antérieures, l'évocation
d'une
promenade nocturne dans le lacis des calli reprenait presque
textuellement un passage du Côté
de Guermantes ; le texte publié en
1986 évite le doublon. |
| 2. |
C'est ce que suggère la suppression de
la visite au baptistère de Saint-Marc. |
|
| EXTRAIT |
Le soir je sortais seul au milieu de la ville
enchantée,
où je me trouvais au milieu de quartiers nouveaux comme un
personnage des Mille
et une Nuits.
Il était bien rare que je ne découvrisse pas au
hasard de
mes promenades quelque place inconnue et spacieuse dont aucun guide,
aucun voyageur, ne m'avaient parlé.
Je
m'étais engagé dans un réseau de
petites ruelles,
de calli divisant en tous sens, de leurs rainures, le morceau de Venise
découpé entre un canal et la lagune, comme s'il
avait
cristallisé suivant ces formes innombrables,
ténues et
minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues,
il
semblait que dans la matière cristallisée se
fût
produite une distension. Un vaste et somptueux campo à qui
je
n'eusse assurément pas, dans ce réseau de petites
rues,
pu deviner cette importance ni même trouver une place,
s'étendait devant moi, entouré de charmants
palais,
pâle de clair de lune. C'était un de ces ensembles
architecturaux vers lesquels, dans une autre ville, les rues se
dirigent, vous conduisent et le désignent. Ici, il semblait
exprès caché dans un entrecroisement de ruelles,
comme
ces palais de contes orientaux où on mène la nuit
un
personnage qui, ramené chez lui avant le jour, ne doit pas
pouvoir retrouver la demeure magique où il finit par croire
qu'il n'est allé qu'en rêve.
Le
lendemain je partais à la recherche de ma belle place
nocturne,
je suivais ces calli qui se ressemblaient toutes et se refusaient
à me donner le moindre renseignement, sauf pour
m'égarer
mieux. Parfois un vague indice que je croyais reconnaître me
faisait supposer que j'allais voir apparaître dans sa
claustration, sa solitude et son silence, la belle place
exilée.
À ce moment, quelque mauvais génie qui avait pris
l'apparence d'une nouvelle calle me faisait rebrousser chemin
malgré moi et je me trouvais brusquement ramené
au Grand
Canal. Et comme il n'y a pas entre le souvenir d'un rêve et
le
souvenir d'une réalité de grandes
différences, je
finissais par me demander si ce n'était pas pendant mon
sommeil
que s'était produit, dans un sombre morceeau de
cristallisation
vénitienne, cet étrange flottement qui offrait
une vaste
place entourée de palais romantiques à la
méditation du clair de lune.
☐ pp. 150-151 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- «
Albertine disparue » (À la recherche du temps
perdu, VII)
2 vol., Paris : Ed. de la Nouvelle revue française,
1925
- « La
fugitive » in À
la recherche du temps perdu, tome 3, texte
établi et présenté par Pierre Clarac
et
André Ferré, Paris : Gallimard
(Bibliothèque
de la Pléiade), 1954
- « Albertine
disparue » in À
la recherche du temps perdu, tome 4, éd.
sous la dir. de Jean-Yves Tadié, Paris : Gallimard
(Bibliothèque de la Pléiade), 1989
- « Albertine
disparue » éd. par Anne Chevalier,
Paris : Gallimard (Folio, 2139), 1990
- « Albertine
disparue » éd. par Jean Milly,
Paris : Honoré Champion, 1992
- « La
fugitive, Cahiers d'Albertine
disparue » éd. par Nathalie
Mauriac Dyer, Paris : Librairie générale
française (Le
Livre de poche, 7395), 1993
- « Albertine
disparue : deuxième partie de Sodome et
Gomorrhe III » éd. par Jean
Milly, Paris :
Flammarion (GF, 1153), 2003
- « Albertine
disparue » éd. par Luc Fraisse,
Paris :
Librairie générale française (Le Livre de poche, 31447), 2009
- « La
fugitive » (À la recherche du temps perdu
VI),
éd. de Luc Fraisse, Paris : Classiques Garnier
(Bibliothèque de littérature du XXe
siècle, 20),
2017
|
- Peter Collier, « Mosaici
proustiani : Venezia nella Recherche »,
Bologna : Il Mulino (Intersezioni,
32), 1986 ;
« Proust and Venice »,
Cambridge : Cambridge university press, 1989
- Nathalie
Mauriac Dyer, Genèse
de la « Ruine de Venise »,
Item (Institut des textes & manuscrits modernes), 2007 [en
ligne]
|
|
|
| mise-à-jour : 29
septembre 2017 |
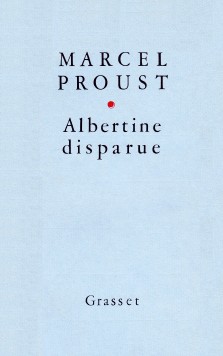
|
|
|
|