|
La
nuit viennent les renards / Cees Nooteboom ; traduit du
néerlandais par Philippe Noble. - Arles : Actes
sud, 2011.
- 157 p. ; 22 cm.
ISBN
978-2-7427-9515-4
|
|
Cees
Nooteboom regarde la mort sans détourner les yeux, et
parfois
l'installe au premier plan, dans un roman — Le chevalier est mort
par exemple —, ou dans le récit d'une
suite de visites à d'illustres
disparus — Tumbas : tombes de
poètes et de penseurs, où l'on
retrouve parmi d'autres Chateaubriand au Grand-Bé et
Stevenson à Upolu.
Dans les nouvelles qui forment La nuit viennent les renards, Cees
Nooteboom creuse cette veine et met en scène les
questions, trop souvent refoulées, que suscite
l'inquiétante proximité qui persiste entre ceux
qui ont
vécu et ceux qui vivent encore.
Décor insulaire
souvent : scène circonscrite où l'usure
du temps
semble mise en doute, où tout avive d'anciennes
affinités ? “ La mer reste la
même et
vient battre doucement la paroi du quai. Tout le reste est
interchangeable, arsenal à meubler les
souvenirs ” (Gondoles,
p. 12).
À
Venise, en
Sardaigne, à Minorque — où
l'auteur
réside une partie de
l'année —, les lieux paraissent également aptes à égarer la
mémoire, à conjurer les effets les plus
évidents de
l'absence, à maintenir la sensibilité d'un fil
qu'on
pourrait croire brisé.
|
| EXTRAIT |
Au
bout du chemin se dresse un phare entouré de quelques
bâtiments. La tour est inoccupée, les
bâtiments sont
inhabités, la grande lumière tournante est
allumée
automatiquement à distance après le coucher du
soleil.
Autrefois, beaucoup de bateaux faisaient naufrage par ici. Je connais
leurs noms, quand je marche de ce côté je les
prononce
à haute voix, cela fait comme une litanie. Le terrain du
phare
est interdit au public, il est entouré de murs, mais je
connais
un passage. En m'approchant, j'entends le bruit de la mer, à
la
fois fureur et exultation. Je viens ici pour danser, c'est ce que je
n'ai jamais pu dire à mon père. Le vent danse
avec moi,
il me serre de près, il entraîne mon corps avec
une
brutalité irrésistible, je me laisse conduire, je
dois
faire attention de ne pas me laisser culbuter. Les rochers ont ici des
pointes acérées, parfois je m'y érafle
ou je m'y
cogne, avant je devais toujours cacher ces blessures. A partir du
phare, il y avait dans le temps un sentier qui descendait vers la
crique où la mer, tout en bas, se
déchaîne. Ce
n'est plus aujourd'hui qu'une vague trace puisque personne n'y vient
plus, les pierres coupantes vous empêchent presque de
marcher. Je
ne peux me retenir nulle part, mais je veux aller jusqu'au bout, entrer
dans cette fureur extatique. La houle, voilà ce que
c'est :
la guerre, le danger. De grandes plaines grises, qui sont
soulevées et fracassées contre les rochers. Elle
s'élèvent en prenant un gigantesque
élan, elles se
creusent de l'intérieur comme si elles voulaient s'envoler
dans
les airs. Il y a de toutes les couleurs dans ce gris, tantôt
il
est bleuâtre et parcouru de reflets
vénéneux comme
le pétrole, tantôt noir et terne comme un suaire.
Furie,
écume qui cingle les rochers et semble un instant se dresser
à la verticale dans le ciel sombre, avant de s'effondrer et
de
s'engloutir dans le noir qui se retire pour lancer un nouvel assaut,
plus sauvage encore. Coups de fouet, cris poussés par des
géants. C'est pour cela que je viens, pour ces cris. Au
début je n'ose pas — tout en sachant que
personne ne
peut me voir ou m'entendre — mais peu à
peu je
commence à répondre aux cris, d'abord de
façon
encore retenue, si bien que je ne m'entends pas moi-même,
puis de
plus en plus fort, je crie pour contrer les cris, je hurle plus fort
que cent mouettes, je crie pour atteindre les morts qui se sont
noyés ici, je les appelle et ils me répondent, je
sais
que je voudrais disparaître dans les profondeurs, perdue dans
ce
mouvement de balancement, et je sais que j'en suis incapable, que la
danse est terminée, que je vais reprendre le long chemin du
retour, poursuivie par les coups de cravache du vent,
flagellée
parce qu'une fois de plus, je me suis
révélée trop
petite. J'ai perdu le vent du nord, comme nous disons ici, he
perdido la tramontana.
Cela signifie naturellement qu'on ne sait plus où on en est,
mais ce n'est pas le cas, je sais très bien où
j'en suis.
J'ai été heureuse, mais je n'ai personne
à qui le
raconter. Je n'ai qu'à attendre que la tempête et
la mer
m'appellent de nouveau au point extrême. C'est notre accord.
☐
Le point extrême, pp.
154-155 |
|
| COMPLÉMENT
BIBLIOGRAPHIQUE |
- « 's
Nachts komen de vossen », Amsterdam : De
Bezige bij, 2009
|
|
|
|
|
| mise-à-jour : 2 juin 2022 |
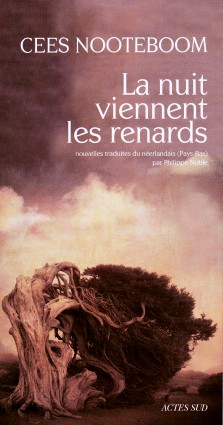
|
|
|
|