|
L'île
Atlantique / Tony Duvert. - Paris : Les Éd. de
Minuit,
2005. - 323 p. ; 18 cm. - (Double, 33).
ISBN
2-7073-1933-3
|
NOTE
DE L'ÉDITEUR
:
Dans une île de la côte
Atlantique, des garçons,
âgés de sept à quatorze ans, vivent
clandestinement
une existence autonome. Issus de familles que tout oppose, du fils de
maraîcher au fils de notable, leur bande se livre
à des
chapardages, puis à des cambriolages en règle,
avec
toutes les conséquences qui s'ensuivent.
Avec Duvert, pour la
première fois, peut-être, dans la
littérature, on découvre le monde uniquement du
point de
vue de l'enfant. Les adultes, dans leur comportement le plus intime,
restent des parents. Ce récit, d'une écriture
aussi
claire que maîtrisée, est la fois plein d'humour
et de
violence..
| ❙ | Tony Duvert
(1945-2008) a publié douze ouvrages aux Éditions
de Minuit de 1967 à 1989. Paysage de fantaisie a
obtenu le Prix Médicis en 1973. |
|
|
BERTRAND
POIROT-DELPECH :
L’île Atlantique pourrait être
l’île de
Ré. Même site, même climat, mais surtout
même
population à la fois entretenue et
détraquée par
les invasions estivales. Le chef-lieu, vingt-cinq mille âmes,
compte en fait vingt-cinq mille corps, que ne
réfrènent
plus les craintes du curé et du qu’en-dira-t-on.
Quand ces peurs
ancestrales régnaient, les enfants trouvaient
déjà
le moyen de les braver. Maintenant que les interdits vacillent, ils
s’en donnent à cœur joie. Le vieil adage
a
vécu : les enfants du Bon Dieu doivent
être pris, bel
et bien, pour des canards sauvages.
[…]
L’auteur laisse
percer son sentiment sur cette jungle. Il I’impute aux
nantis,
aux quinquagénaires à
« moumoutes »
qui miment, en vacances, la liberté confisquée
aux vrais
adolescents. Il en veut aux notables d’engluer les jeunes
dans le
piège de la charité. Les parents sont suspects de
haïr leur progéniture, de ne veiller
qu’à la
« mangeaille » et aux lessives,
de ne croire
qu’au « talion »
— « il
faut payer », — qu’à
la taloche. Les
enfants sont approuvés de répliquer en barbares
tranquilles à cette gérontocratie sans
cœur ni
idéal, d’en vouloir à leurs
médiocres
parents de ne pas savoir se vendre aux riches. Faire le Mal, si tant
est que l’éducation l’identifie encore,
devient la
seule façon d’échapper à ce
que l’un
d’eux appelle « une marée de
dégoût ».
Mais L’Île
Atlantique
ne fait que sous-entendre cette opinion sur la crise des valeurs et des
liens familiaux. Le roman se veut avant tout descriptif. Et il se
révèle, dans les moindres détails
d’une
bonne quinzaine de personnages, criant de vérité.
Qu’il
s’agisse d’enfants ou d’adultes,
d’épiciers radoteurs ou d’enseignants
cuistres,
d’une mère et d’une fille parlant
rôtissoire,
ou d’un pilier de bistrot causant croustade aux fruits de
mer,
c’est d’une observation, d’une justesse
et
d’une cocasserie exceptionnelles.
Obsédés par la
sexualité enfantine, les précédents
livres de
Duvert ne laissaient pas prévoir cette ouverture
à tous
les aspects d’une réalité sociale
complexe,
grouillante, savoureuse.
[…]
|
| EXTRAIT |
Pellisson
repensa aux côtés moches de leurs diverses
entreprises. Il
avait un peu menti en disant à Guillard qu'il en faisait des
cauchemars. Cependant, il y avait ce fond d'inquiétude
tenace.
L'impression, par moment, d'une horrible histoire
détraquée, qui n'aurait jamais dû
commencer. On ne
s'était occupé que
d'impunité ; on
était à peine étonné de
n'avoir
été ni découvert, ni pris, ni
même
soupçonné ; on avait les meilleurs
raisons de
s'estimer innocent ; mais quelque chose de lourd et de noir,
d'écœurant, d'énorme, grossissait par
en dessous.
Ce n'était pas un remords, le sentiment d'une faute, d'une
saloperie, d'une erreur. C'était une peur
irraisonnée,
dégoûtante, géante.
Hervé
Pellisson l'éprouvait particulièrement quand
il était seul, dans la rue, comme à
présent. La
chose massive, insupportable, s'éveillait en lui et
— sans
insinuer, sans endolorir, sans mordre — diffusait doucement,
monstrueusement, la panique. Impossible de lutter. Cela se
répandait. Ça commençait par cette
impression de
vide, de lâchage : et cela virait peu à
peu en boue
gluante, fade, incolore. On devenait cette boue. C'était
pire
que d'être battu, abandonné, puni.
C'était une
nudité insurmontable, une solitude blême, immense
et
flasque comme un jour humide.
Quel
rapport entre cela et quelques chapardages, des cambriolages
d'amateur, des jeux justes et inoffensifs (Hervé les voyait
tels) ?
Au moins
un : quand on éprouvait cette énorme
marée de dégoût, de détresse
et de peur, on
avait bientôt une envie folle, absurde, de voler.
Simultanément, Hervé décida ainsi de
renoncer
à tout délit, et cherchait des yeux une occasion
d'en
accomplir un immédiatement, et le plus violent, le plus gros
possible.
Il faillit
arracher le sac à main d'une passante, jugea
l'environnement trop défavorable, et
pénétra dans
un uniprix.
☐ pp. 223-224 |
|
| COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE |
- « L'île Atlantique », Paris : Les éd. de
Minuit,
1979 ; Paris : Seuil (Points-roman, 301), 1988
|
|
|
| mise-à-jour : 29
août 2008 |
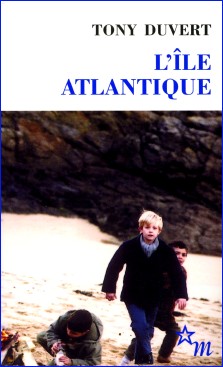
|
|
|
|